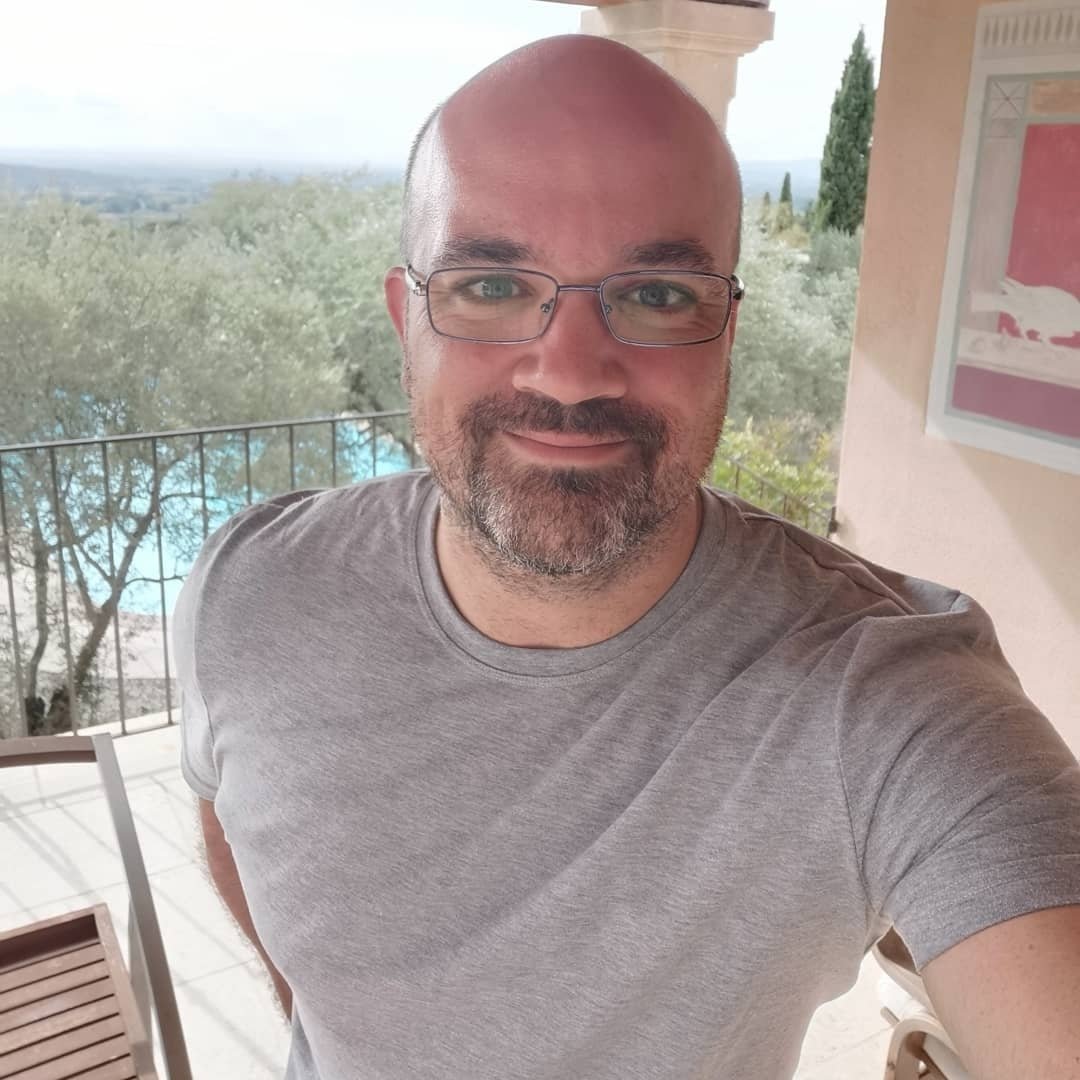Contrairement à l'idée traditionnelle d'un cerveau réactif, cette approche affirme que le cerveau est un organe de prédiction, qui anticipe les perceptions à venir à partir de modèles internes, et ajuste son activité selon les écarts avec la réalité sensorielle.
Origines et fondements du predictive processing
Il s'appuie sur les travaux antérieurs de Karl Friston, qui a élargi le cadre au fonctionnement global du cerveau via la théorie de l'énergie libre (Free Energy Principle).
Selon cette théorie, le cerveau agit pour minimiser l'erreur de prédiction — l'écart entre ce qu'il anticipe et ce qu'il perçoit — afin de conserver une forme de stabilité interne face à l'incertitude du monde extérieur.
Comment fonctionne le predictive processing ?
1. Génération de prédictions (top-down)
2. Réception des signaux sensoriels (bottom-up)
3. Comparaison et détection d'erreur
4. Ajustement des modèles internes
Exemple concret : marcher dans une rue connue
Votre cerveau anticipe ce qu'il va percevoir : le bruit des voitures, la couleur du bâtiment, la texture du trottoir.
Un jour, un chantier bloque la route et fait du bruit : votre cerveau détecte une erreur de prédiction.
Il doit donc mettre à jour son modèle de cette rue — c'est ainsi que l'on s'adapte à un environnement changeant.
Le cerveau, une machine bayésienne
Selon cette logique, la perception est une inférence : elle résulte d'un calcul de probabilité entre ce que l'on attend et ce que l'on perçoit.
Le cerveau fonctionne donc comme un modèle génératif hiérarchique qui évalue en permanence l'état du monde, à tous les niveaux (sensoriel, moteur, cognitif).
Applications cliniques du predictive processing
Schizophrénie
Autisme
Anxiété
Douleur chronique
Predictive processing et interoception
C'est le champ de l'interoception, étudié notamment par le neuroscientifique Antonio Damasio ou encore Anil Seth.
Les émotions et sensations internes seraient le résultat de prédictions sur l'état du corps, mises à l'épreuve par les signaux physiologiques réels.
Un déséquilibre entre prédiction et sensation pourrait ainsi expliquer certains troubles somatoformes ou psychosomatiques.
Conclusion : nous percevons nos attentes, pas le monde brut
Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre cerveau anticipe qu'il devrait être.
En permanence, nous actualisons nos modèles mentaux pour minimiser l'erreur de prédiction et mieux naviguer dans l'incertitude.
La perception devient ainsi un dialogue incessant entre attente et réalité, entre intérieur et extérieur — un processus dynamique et profondément adaptatif.
Références
- Rao, R. P., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience*, 2(1), 79–87.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- Pellicano, E., & Burr, D. (2012). When the world becomes ‘too real': a Bayesian explanation of autistic perception. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(10), 504–510.
- Tabor, A., Thacker, M. A., Moseley, G. L., & Holmes, E. A. (2017). Pain: A Statistical Account. *PLoS Computational Biology*, 13(1), e1005142.
- Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences*, 36(3), 181–204.
- Seth, A. K. (2013). Interoceptive inference, emotion, and the embodied self. *Trends in Cognitive Sciences*, 17(11), 565–573.